Comment réussir à apprendre intelligemment ?
Comment apprendre intelligemment ?
Au collège, au lycée ou encore en études supérieures, plus on avance dans l’année et plus les notions vues en cours sont complexes. C’est pour cela qu’en général on peut constater, à partir du second trimestre, une plus grande insatisfaction des résultats obtenus. Si on écoute le point de vue de l’élève, ce serait la faute du professeur. Si on se place du point de vue du professeur, ce serait l’élève qui ne fournirait pas assez d’efforts. Il existe une troisième explication. Ce n’est pas uniquement la quantité d’efforts qui est en cause, c’est aussi leur qualité. En effet, il y a des élèves qui bûchent énormément et n’obtiennent que peu de bonnes notes. Lorsque nous les rencontrons, ils nous confient qu’arrivés à l’évaluation, ils n’arrivaient pas à répondre aux questions. Ou bien, ils ne voyaient pas le lien de ces dernières avec la leçon. Ou bien, ils nous disent qu’ils ne réussissaient pas à tout retenir. Par la suite, ils perdent confiance en eux et en arrivent à penser qu’ils ne sont pas faits pour la matière. Par conséquent, nous nous engageons à les aider à changer leurs croyances. S’ils n’arrivent pas à se souvenir de la leçon ou qu’ils ne comprennent pas un énoncé, c’est qu’il y a un problème méthodologique lors de leurs révisions. Avec une bonne méthode, on peut se souvenir des notions plus longtemps. On peut effectuer des connexions avec d’autres concepts afin de produire un raisonnement. Même pendant les séances à l’école, cela aide à comprendre plus facilement ce qui expliqué, à le retenir et le restituer plus tard de manière cohérente. Nous leur enseignons donc comment apprendre intelligemment leurs leçons.
Cependant, les méthodes que nous allons voir ensemble requièrent de comprendre comment le cerveau parvient à enregistrer des informations. Pour cela, je vous encourage à consulter d’abord notre article sur « comment réussir à entretenir et améliorer sa mémoire ». Dans ce dernier, nous avons vu que le contenu de la mémoire épisodique est transféré vers la mémoire sémantique. En d’autres termes, le vécu se transforme en connaissances. Donc, nous allons utiliser nos moyens de perception (vue, ouïe, toucher, odorat, goût) pour appréhender ce que nous sommes en train de vivre et ensuite, en retirer des informations théoriques et pratiques. Toutefois, pour que ces connaissances soient durables, c’est-à-dire que l’on puisse s’en souvenir plus longtemps, il y a des conditions.
La première est l’importance de l’information. Vous avez surement remarqué la facilité avec laquelle on peut se souvenir de ce qui nous intéresse beaucoup. Je prends l’exemple de mes élèves qui peuvent me raconter dans le détail leur passage préféré d’un film ou d’une série alors qu’ils ne l’ont vu qu’une seule fois. Ces mêmes élèves rencontrent des difficultés à me restituer certains chapitres de leçons vus plusieurs fois. En conséquence, si on arrive à se convaincre que c’est important, on aura moins d’effort à faire pour s’en rappeler.
Si on n’y arrive pas, il y a une autre condition qui est la répétition. C’est la bonne vieille méthode dite du « par cœur bête et méchant ». Mais attention ! Nous n’avons pas tous les mêmes aptitudes. Chacun d’entre nous possède une mémoire perceptive qui est plus développée pour un sens plutôt qu’un autre. Si c’est la mémoire visuelle qui est la meilleure alors il est nécessaire d’effectuer plusieurs lectures silencieuses pour retenir un paragraphe. Si c’est la mémoire auditive, il est nécessaire d’effectuer plusieurs lectures à haute voix. Et enfin si c’est la mémoire du toucher, il faut recopier plusieurs fois le texte. Tout cela va demander de la régularité et des efforts, mais les résultats seront au rendez-vous.
La condition suivante est moins usante, il s’agit du contexte émotionnel. Nous avons tous une plus grande aisance à retenir des informations lorsqu’elles sont associées à une émotion forte. Par exemple, on se souvient de nombreux détails associés à un moment de grande joie ou de grande peur. Faites le test ! Pensez à l’instant de votre vie que vous avez préféré - en dehors de maintenant – et comparez-le à un autre jour comme il y a deux ou trois semaines à 14h45. Avez-vous autant de détails en mémoire pour les deux ? Clairement non si les deux moments sont bien distincts. Maintenant, comment faire pour lier une émotion forte à une séance de révision ? Il y a bien une ou deux façons de faire. Avant de commencer, il faut aller voir des personnes qui ont de l’importance pour soi et s’engager auprès d’elle. Il faut affirmer publiquement que l’on va réussir à tout apprendre. Cela aura, en outre, pour effet d’éviter de remettre à plus tard les tâches à réaliser. Autre méthode, on pourrait lier chaque erreur commise à un gage comme exécuter une série de pompes ou d’abdominaux ou même accomplir les corvées à la place d’une autre personne. En revanche, il faut récompenser chaque progrès ne serait-ce que verbalement. Dans les deux cas, cela aura un impact positif sur le mental comme sur le physique.
Néanmoins, il y a des situations où on ne fait rien de précis et pourtant on va se souvenir de choses qui nous paraissent insignifiantes. C’est dû à la dernière condition qui est le contexte environnemental. Il s’agit de l’ambiance dans laquelle on se trouve. Si elle est suffisamment propice, on peut aussi enregistrer convenablement toutes sortes de données. Ainsi, pour bien apprendre, il faut se placer dans ce contexte favorable. Cela permettra d’être dans les meilleures dispositions.
Tout ce que nous venons d’aborder est indispensable pour retenir mais ce n’est pas encore suffisant pour s’améliorer significativement dans une matière. Voyons maintenant comment faire pour apprendre et mieux comprendre en même temps.
Juste avant, je vais dénoncer une erreur courante chez trop d’élèves. Dans le cas des matières scientifiques. Ou bien, ils n’apprennent rien et se contentent d’effectuer des exercices. Ou bien, ils n’apprennent que les formules. Ceci fonctionne au collège mais ce n’est qu’une apparence. En fait, ils creusent leurs lacunes et cela se répercutera sur les notes au lycée ou en études supérieures. Afin d’éviter que cela ne se produise, ils doivent structurer leur façon d’apprendre.
Un principe simple à respecter est qu’il n’existe pas de vérité universelle en sciences. Chaque notion est donc conditionnelle. Par conséquent, on s’intéresse au contexte avant tout. À quel moment ? Qui est concerné ? À quelles conditions ? Pourquoi ? Dans quelle configuration ? Ce sont des questions que l’on peut se poser pour bien cerner la situation. Prenons l’exemple du théorème de Pythagore. Pour un collégien, il n’est applicable que si le triangle est rectangle. Sans cette condition, la formule ne sert à rien. Donc, en premier, il faut exprimer clairement et retenir toutes les conditions reliées aux concepts que l’on étudie. Une fois cela fait, il faut apprendre les définitions. Comme le contexte sera connu, elles seront plus simples à saisir. Toutefois, pour s’assurer de bien y arriver, il y a une astuce. J’appelle ça « mettre à l’épreuve la définition ». L’idée est d’essayer de se fabriquer des exemples et des contre-exemples. Cela permettra de mieux appréhender les possibilités et les limites de cette définition. Reprenons le cas du théorème de Pythagore. On peut, au brouillon, dessiner des triangles rectangles avec des mesures différentes et vérifier à chaque fois que le carré de l’hypoténuse est bien égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On peut ensuite dessiner un triangle quelconque et s’assurer que la formule précédente ne s’applique pas.
Après avoir fait cela, il ne reste plus qu’à conserver en mémoire ce qui a été traité. L’élève pourrait s’aider de fiches bien organisées qui ferait ressortir le plan du cours. Puis, pour chaque données, les conditions, les définitions et les exemples. Petite parenthèse, afin de bien rédiger les fiches, on peut noter que le cerveau retient plus facilement les mots courts, proches phonologiquement ou encore proches sémantiquement. Cette information reste utile pour les élèves qui ne font pas de fiches. Dans tous les cas, ce n’est qu’après avoir appris que l’on peut passer aux exercices.
Je terminerai en insistant là-dessus. Plus la leçon est difficile et plus il faut l’apprendre par cœur. La compréhension se fera, au pire, durant la pratique des exercices. Un indicateur fiable qui montre que l’on est prêt, c’est quand on arrive à expliquer le cours à quelqu’un d’autre sans aucune hésitation. C’est l’objectif à atteindre.
Si vous êtes concernés, il ne vous reste plus qu’à mettre en application tous ces conseils. Entrainez-vous et essayez expliquez aux autres.
À bientôt !



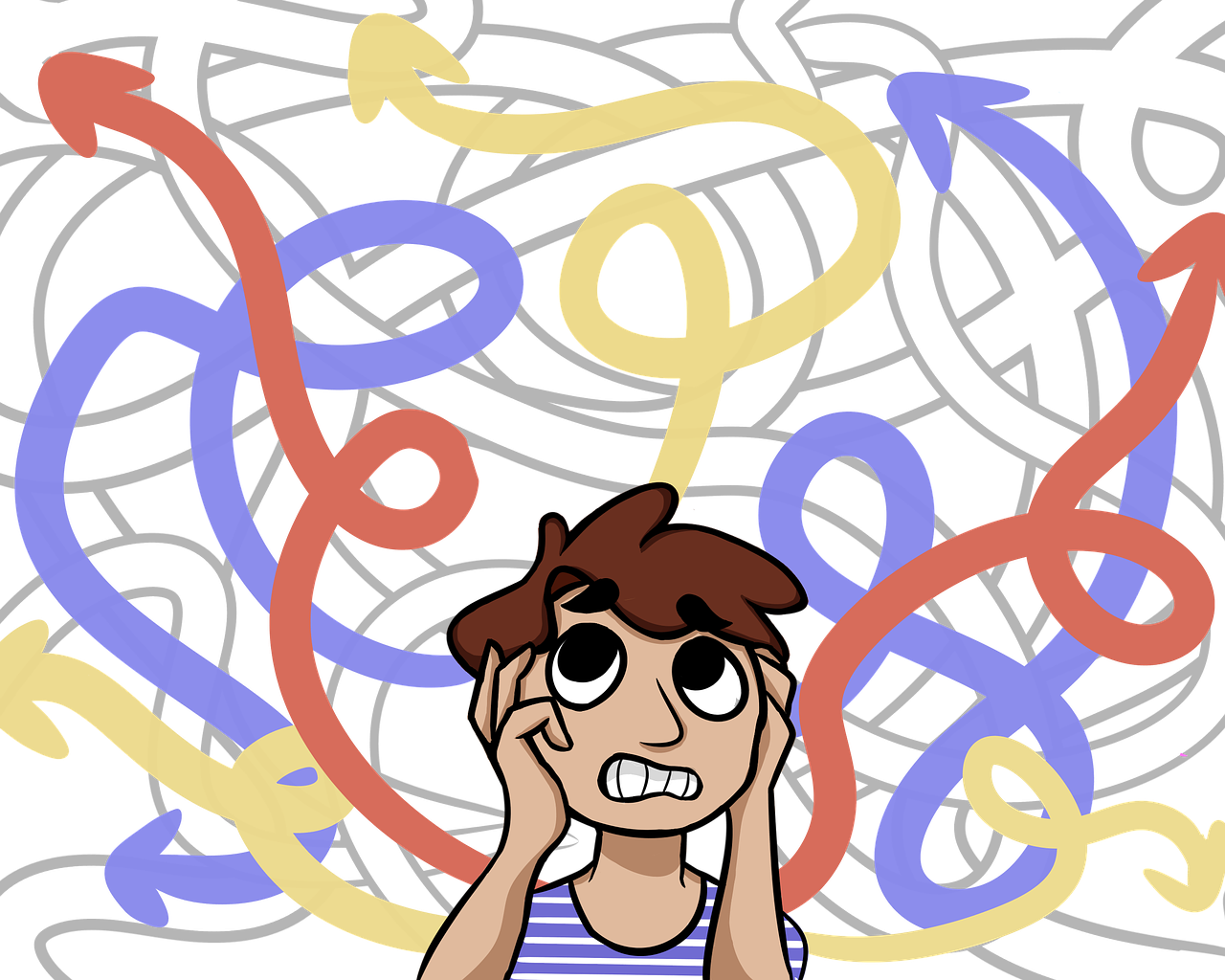



.jpg)



 Dates parcoursup
Dates parcoursup Dates épreuves écrites Brevet DNB 2025
Dates épreuves écrites Brevet DNB 2025 Les dates et les horaires des épreuves du Bac Général session 2025
Les dates et les horaires des épreuves du Bac Général session 2025 À quoi sert la mention au BREVET ?
À quoi sert la mention au BREVET ?