Comment réussir à s'exercer efficacement en sciences.
Comment s’exercer efficacement en sciences.
Dans les matières scientifiques, comme les mathématiques ou les sciences physiques, s’exercer est indispensable. Cependant, pour de nombreux élèves ou étudiants les exercices sont sources de tracas, de contrariétés ou d’inquiétudes. Certains élèves trouvent qu’il y en aurait trop à faire, pour d’autres, ils seraient difficiles et provoqueraient des maux de tête. Même parmi les élèves qui aiment en faire, on peut observer des erreurs méthodologiques qui les pénalisent. Pour moi, ces élèves n’ont pas la bonne perception. Ils n’ont pas encore compris que s’exercer permet de comprendre les notions vues dans les leçons. Mieux, cela permet d’en appréhender le champ d’application et les limites. En d’autres termes, dans quelles conditions peut-on faire appel à ces notions ? Comment s’en servir et dans quelles situations elles ne servent pas ? Effectuer des exercices supprime le flou qui persisterait après avoir étudié ses leçons. En outre, si on n’en effectue pas assez, cela va rendre très difficile de passer du théorique au concret. L’objectif étant qu’un jour on soit dans la capacité d’appliquer correctement ce qui a été vu à l’école si on se trouve en situation pour son métier. Si on souhaite bénéficier de tous les avantages que peuvent apporter des exercices bien choisis, il faut alors adopter la bonne attitude. Nous allons voir ensemble quelles sont les bonnes pratiques afin de réussir à s’exercer efficacement.
Dans l’article sur « comment apprendre intelligemment », nous avions vus qu’une séance d’entraînement doit commencer par des exercices que l’on maîtrise déjà. Ensuite, on effectue des applications directes du cours. Enfin on peut se pencher sur des énoncés qui requièrent des savoirs portant sur plusieurs chapitres en même temps. En revanche, nous n’avons pas précisé en quoi cela consiste de bien effectuer un exercice.
Effectuer correctement un exercice, c’est d’abord comprendre son énoncé, c’est-à-dire saisir ce qui est demandé. C’est pour cela qu’il faut connaitre le vocabulaire sur le bout des doigts.
Une fois les instructions de l’énoncé comprises, il est crucial de réussir à produire un raisonnement cohérent. Cela signifie que l’élève parvienne à comprendre les relations de causes à effets entre les différentes notions. Cela demande de la patience et de la discipline. Ce raisonnement constitue la base d’une justification ou d’une démonstration. Par conséquent, il est soumis à l’utilisation stricte des règles de la logique (implication, équivalence, négation, modus ponens, etc…). Il existe des raisonnements types comme la déduction, la contraposée, le raisonnement par l’absurde ou le raisonnement par récurrence. Il faut donc s’entraîner à les utiliser.
Dès que le raisonnement est maîtrisé, il faut savoir comment le rédiger correctement. La rédaction permet de communiquer avec le lecteur. L’élève n’écrit pas pour lui-même. Il doit se faire comprendre c’est à dire fournir un effort d’écriture et respecter autant que possible les règles de grammaire ou d’orthographe. Il doit donc être rigoureux. En particulier sur les notations conventionnelles. Prenons l’exemple des mathématiques. La notation est stricte, or les élèves s’imaginent parfois à tort qu’elle a juste une fonction esthétique. Il s’agit d’une erreur à corriger rapidement car modifier les notations modifie le sens du propos. Particulièrement dans le cas où il y a des calculs à effectuer.
Justement, réussir ses calculs est l’étape suivante. Cela nécessite de savoir convenablement se servir des théorèmes et des formules. C’est l’étape qui impose d’avoir des automatismes. Réussir ses calculs sans erreur doit amener aux bons résultats et surtout aux bonnes conclusions. Il faut d’ailleurs systématiquement les écrire. Ce n’est qu’une fois fait que l’on pourra considérer que l’on a terminé.
Les étapes que nous venons d’aborder sont exigeantes. C’est pour cela qu’il ne faut pas les entamer avec n’importe quel état d’esprit. Afin de pouvoir se les approprier il faut éviter d’avoir, comme nous l’avons vu précédemment, une attitude inadéquate qui atténuerait leurs effets. Par exemple, il y a un profil d’élève qui ne sait jamais comment démarrer. Il se retrouve comme figé devant son cahier comme s’il était devant un épisode de sa série préférée. Il ne faut jamais être passif face à un exercice. Il ne faut pas craindre d’écrire quelque chose, quitte à commettre des erreurs. C’est en apprenant de ces dernières que l’on progresse. Quand je tombe sur ce type d’élève je les oblige à rédiger une réponse, même fausse, car c’est après avoir eu la correction qu’ils sauront comment faire la fois suivante.
Autre exemple de mauvais état d’esprit, lorsqu’un élève est beaucoup trop pressé. Il saute des étapes du raisonnement, de la rédaction ou des calculs. Il ne s’intéresse qu’au résultat et c’est catastrophique car il ne comprend pas ce qu’il fait. Il s’expose au fait de prendre la mauvaise habitude de ne pas effectuer l’étape en question et l’oubliera durant une évaluation. Pire ! Il arrive qu’il évite d’effectuer certains exercices en croyant gagner du temps. Il ne faut pas perdre de vue que l’objectif de l’entrainement n’est pas juste d’apprendre une recette toute faite. Si un ingrédient venait à manquer on serait perdu. Alors que si on comprend chaque détail, que l’on a des connaissances plus riches et plus précises sur le sujet alors on peut s’adapter à chaque fois. C’est pour cela qu’il est indispensable de tout faire en détail à l’entrainement.
En parlant d’élèves pressés, il y a le profil de l’élève qui ne refait jamais le même type d’exercice sous prétexte qu’il a compris et qu’il veut vite passer à la suite. Ce n’est pas de la fainéantise mais de l’immaturité. Dans ce cas je leur explique que comprendre est nécessaire mais n’est jamais suffisant. C’est le genre d’élève qui arrive en classe supérieure et qui oublie les cours des années précédentes. Je les oblige à faire et à refaire les mêmes catégories d’exercices jusqu’à les faire acquérir des automatismes.
Toutefois, il ne faut pas confondre ce profil d’élève avec les fainéants comme ceux qui regardent la solution avant d’avoir suffisamment chercher. Si vous avez lu l’article sur comment réussir à apprendre intelligemment, vous savez que c’est justement la difficulté qui va stimuler la mémoire des émotions et rendre utile la lecture de la correction. J’insiste ! Cherchez longtemps avant de la consulter. Ne soyez pas fainéants.
Même s’il y a quand même pire que ceux que l’on vient de décrire. Je parle de ceux qui paniquent et qui ont peur d’en savoir trop. Ils disent qu’il ne faut pas aborder telle ou telle notion car elles n’auraient pas été traitées en cours. Je leur réponds qu’il vaut mieux le savoir et ne pas en avoir besoin que de ne pas savoir et d’en avoir besoin. Surtout que, la plupart du temps, les notions en question seront traitées plus tard dans l’année par leur professeur. C’est le profil le plus pénible.
En revanche, Il ne faut pas le confondre avec l’élève distrait. Ce dernier plus que les autres doit, pour réussir à se concentrer, être dans un environnement propice à l’étude et doit, encore plus que les autres, se lancer en répondant à des questions simples avant d’augmenter progressivement la difficulté.
J’ai parlé de mon expérience personnelle avec ces élèves car j’en rencontre régulièrement dans mes séances de cours privés. Mais comment peuvent-ils faire lorsqu’ils n’ont pas accès à ce genre d’accompagnement ?
Il existe aujourd’hui des tas de sources comme des livres, des sites internet ou des vidéos gratuites pour obtenir des énoncés d’exercices ou des sujets types. Le tout est de se focaliser sur les bonnes séquences d’entrainement qui vont permettre de comprendre les notions puis d’être prêt pour n’importe quelle évaluation. Il faut aussi faire attention à certains défauts. Il y a des livres où la correction n’est pas assez détaillée. Elle présente essentiellement les résultats ou les conclusions. Ce qui est insuffisant. De même pour certains sites internet.
Il y a aussi l’éventualité où la correction est inaccessible à cause des lacunes de celui ou celle qui la regarde. Dans ce cas il faut les combler avant en se servant des manuels des classes antérieures. Je conseille également d’utiliser les cahiers de vacances des classes antérieures car ils font une bonne synthèse des programmes.
Dernier défaut. Sans professeur certains peuvent être tentés de se servir de leur calculatrice. Je le déconseille. On n’utilise jamais la calculatrice à l’entrainement. C’est aussi insensé que de se préparer à courir un marathon en utilisant une moto.
Nous avons fait le tour de mes meilleures recommandations pour réussir sa séance d’entraînement. Il ne vous reste plus qu’à identifier celles qui vous correspondent et les mettre en pratique. Indiquez-moi en commentaire vos résultats.
À bientôt.


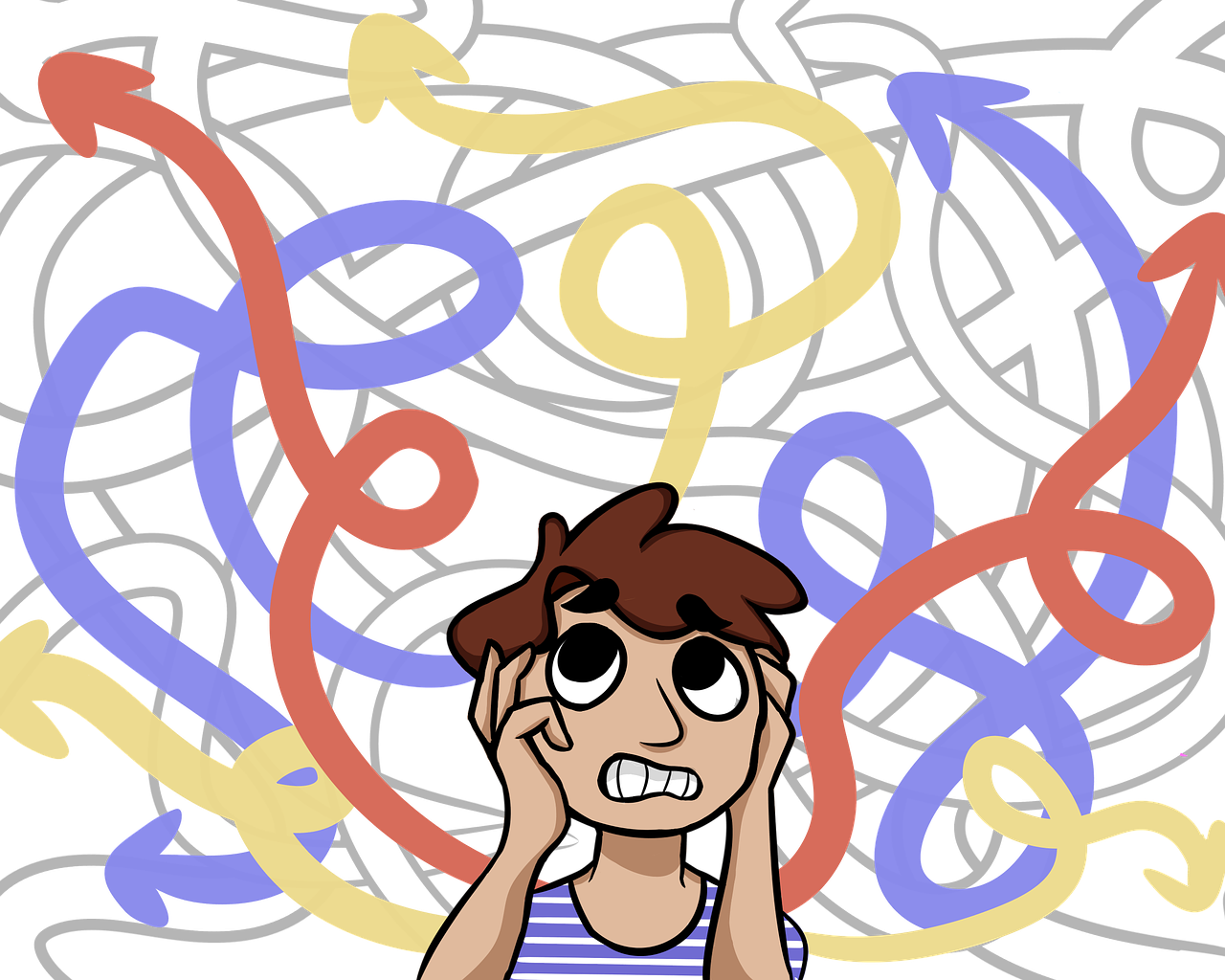



.jpg)




 Dates parcoursup
Dates parcoursup Dates épreuves écrites Brevet DNB 2025
Dates épreuves écrites Brevet DNB 2025 Les dates et les horaires des épreuves du Bac Général session 2025
Les dates et les horaires des épreuves du Bac Général session 2025 À quoi sert la mention au BREVET ?
À quoi sert la mention au BREVET ?