Comment réussir à savoir s'il faut envisager un redoublement
L'article est sous la vidéo
Comment réussir à savoir s’il faut envisager un redoublement
À la fin du troisième trimestre, au collège ou au lycée, certains élèves redoutent le conseil de classe. En fonction de leurs moyennes générales et de leurs appréciations, on leur proposera soit de passer en classe supérieure soit de redoubler.
Celles et ceux à qui l’on propose de recommencer l’année peuvent percevoir cette décision comme une punition. D’abord ils craignent la réaction de leurs parents et les éventuelles réprimandes. Ensuite, ils se sentent parfois comme humiliés par le fait d’aller en cours avec les élèves nés après eux. Ils n’ont pas envie non plus de se séparer des camarades avec lesquels ils ont développés des affinités. En outre, le redoublant craint d’être jugé par les autres élèves de sa classe. Ils pourraient penser qu’il est moins intelligent que les autres. Le pire est que s’ils réussissent l’année d’après, leur succès sera minimisé parce qu’après tout « c’est un(e) redoublant(e) ». Dans ces conditions, faut-il vraiment accepter de refaire l’année ? Et surtout pourquoi ?
Dans l’idéal on aimerait que l’élève redoublant(e) puisse devenir meilleur qu’avant. Que cette expérience lui permette de gagner en confiance. Que cela soit le commencement d’une série de succès jusqu’à l’obtention de tous ses diplômes. Comment savoir si accepter de redoubler aura de tels conséquences ?
Chaque cas est différent, chaque élève a son histoire. Il faut donc ajuster sa réaction.
Dans la suite de cet article, je vais dévoiler quatre questions à se poser afin de prendre la décision adéquate.
Mais avant cela voyons les principales raisons expliquant un échec.
Premièrement, cela peut-être évidemment la conséquence d’un manque de régularité dans les révisions. C’est le cas le plus fréquent que j’ai pu observer dans mon métier.
Quand ils étaient au collège, les élèves étaient habitués à obtenir de bonnes notes sans avoir besoin de s’entrainer. Mais au bout d’un moment cela ne fonctionne plus du tout et les résultats en pâtissent.
Ce phénomène peut être amplifié par de mauvaises fréquentations qui exerceraient une influence néfaste sur leur comportement. Les jeunes ont tendance à faire comme les autres, même lorsque cela peut être nocif.
Lorsque cela ne vient pas des camarades, l’environnement familial, s’il n’est pas stable, peut engendrer aussi des perturbations. Cela peut finir par susciter un désintérêt pour l’étude. J’ai souvent eu à devoir accompagner des élèves dont les parents ne s’entendaient pas, se disputaient souvent, ou pire qui ont divorcé. Trop souvent cela se fait au détriment de leurs enfants qui, la plupart du temps, ont du mal à accepter cette situation.
Même quand tout va bien à la maison, les mauvais résultats peuvent aussi être la conséquence de mauvais choix effectués les années précédentes par les parents. L’élève aurait peut-être dû redoubler et/ou se faire accompagner avant et se serait évité un plus gros échec. Je rappelle qu’avoir juste la moyenne signifie que l’on ne maîtrise pas la moitié du programme. De plus, la difficulté est sensée augmenter. C’est comme en saut en hauteur, si un athlète est passé de justesse, il lui sera presque impossible de franchir la hauteur suivante. C’est pour cela qu’il faut agir le plus tôt possible. Et encore plus lorsque l’on se trouve dans l’une des situations suivantes.
Les causes les plus rares que constituent les limites intellectuelles de l’élève ou encore une mauvaise pédagogie de l’enseignant. Ce sont vraiment les situations les moins fréquentes. Il faut savoir que les notes ne sont pas le reflet de l’intelligence mais, en priorité, de la régularité de l’apprentissage et de la pratique. Ce qui permet à des personnes aux capacités diverses de pouvoir s’en sortir du moment qu’elles s’investissent suffisamment et ce peu importe l’enseignant.
Connaître les motifs pour lesquels il y a eu de mauvais résultats est essentiel. Il ne faut absolument pas se retrouver dans le même contexte ou reproduire les mêmes erreurs. Il faut faire mieux. La réussite scolaire n’est pas optionnelle. Elle est cruciale. Il faut garder en mémoire que, pendant et après les études, la concurrence sera de plus en plus grande.
Il y a aura des candidats issus du monde entier qui vont postuler pour accéder à des établissements du supérieur ou même par la suite à un emploi. Cela est de plus en plus encouragé depuis que le télétravail s’est démocratisé. En outre, les progrès de l’intelligence artificielle et de la robotique vont faciliter notre vie au quotidien mais vont menacer l’existence d’emplois existant. Le niveau d’étude et d’expertise constitueront donc des critères déterminants pour se démarquer.
C’est pour cela que lorsque les notes ne sont pas assez bonnes pour aller en classe supérieure, il faut se poser les questions suivantes.
L’élève souhaite-t-il vraiment y aller ?
Il y a des élèves qui peuvent ressentir une appréhension à l’idée de passer au niveau suivant. Il est préférable de se sentir prêt(e), c’est-à-dire de ne se sentir effrayé ni par les échéances futures, ni par les exigences des enseignants. Cette situation peut être d’ordre émotionnel, psychologique ou simplement une forme d’immaturité. Il faut d’abord s’en occuper en discutant ou encore en faisant appel, si nécessaire, à un professionnel.
Dès que l’élève confirme qu’il ne craint pas d’avancer, on peut aborder la deuxième question.
En cas de passage en classe supérieure, sera-t-il possible de rattraper le retard pris ?
Si la réponse est oui alors il faut juste se poser la troisième question.
Sera-t-il nécessaire de faire appel à un accompagnement extérieur afin de combler ses lacunes ?
Si dans la famille ou si des amis proches ont le temps d’aider gratuitement, alors il ne faut pas hésiter. Dans le cas contraire il existe plein de solutions d’accompagnement payant.
En revanche, si la réponse à la deuxième question est non alors il faut penser sérieusement au redoublement. Mais attention, pour qu’il soit utile, il est impératif que l’élève soit pleinement conscient qu’il est nécessaire de gagner en maturité (cf. comment réussir à gagner en maturité). Il faudra devenir plus ambitieux et fournir des efforts réguliers afin de consolider ses progrès. Il devra éviter le piège dans lequel je suis moi-même tombé quand j’ai refait ma classe de seconde. Je m’étais mis en tête que j’aurais toujours droit à une autre chance. Ce qui a impliqué ma rechute en terminale et un nouveau redoublement. Petite parenthèse, à ce niveau, il n’est pas automatique. J’ai dû écrire une lettre de motivation pour que l’on m’accepte à nouveau. Fin de la parenthèse. En conséquence, il faut garder à l’idée qu’on a déjà eu sa seconde chance et que cela doit rester la dernière fois que cela se produit. Il ne faut donc plus du tout se relâcher. Dernière chose, on ne redouble pas pour les autres mais pour soi-même. Peu importe ce que les autres pensent. C’est pour cela qu’il faudra prendre des distances avec les mauvais exemples et les mauvaises fréquentations. En parallèle, la famille doit apporter son soutien et veiller à ce que l’élève puisse se focaliser sur l’essentiel. Il ne restera plus qu’à se poser la dernière question qui est la même que la troisième mais dans un contexte différent.
Sera-t-il nécessaire de faire appel à un accompagnement extérieur afin de combler ses lacunes ?
La réponse est la même que précédemment, en priorité on cherche une aide gratuite et s’il n’y en a pas de disponible, il ne faut pas hésiter à faire appel à des professionnels.
Un redoublement doit rester une opportunité de s’améliorer et de tout faire mieux. Il faut donc mettre toutes les chances de son côté.
Voilà pour les questions, Si vous êtes vous-même concerné par cette situation et que vous avez besoin de précisions, n’hésitez pas à me poser des questions en commentaire.
Sinon, je vous dis à bientôt.


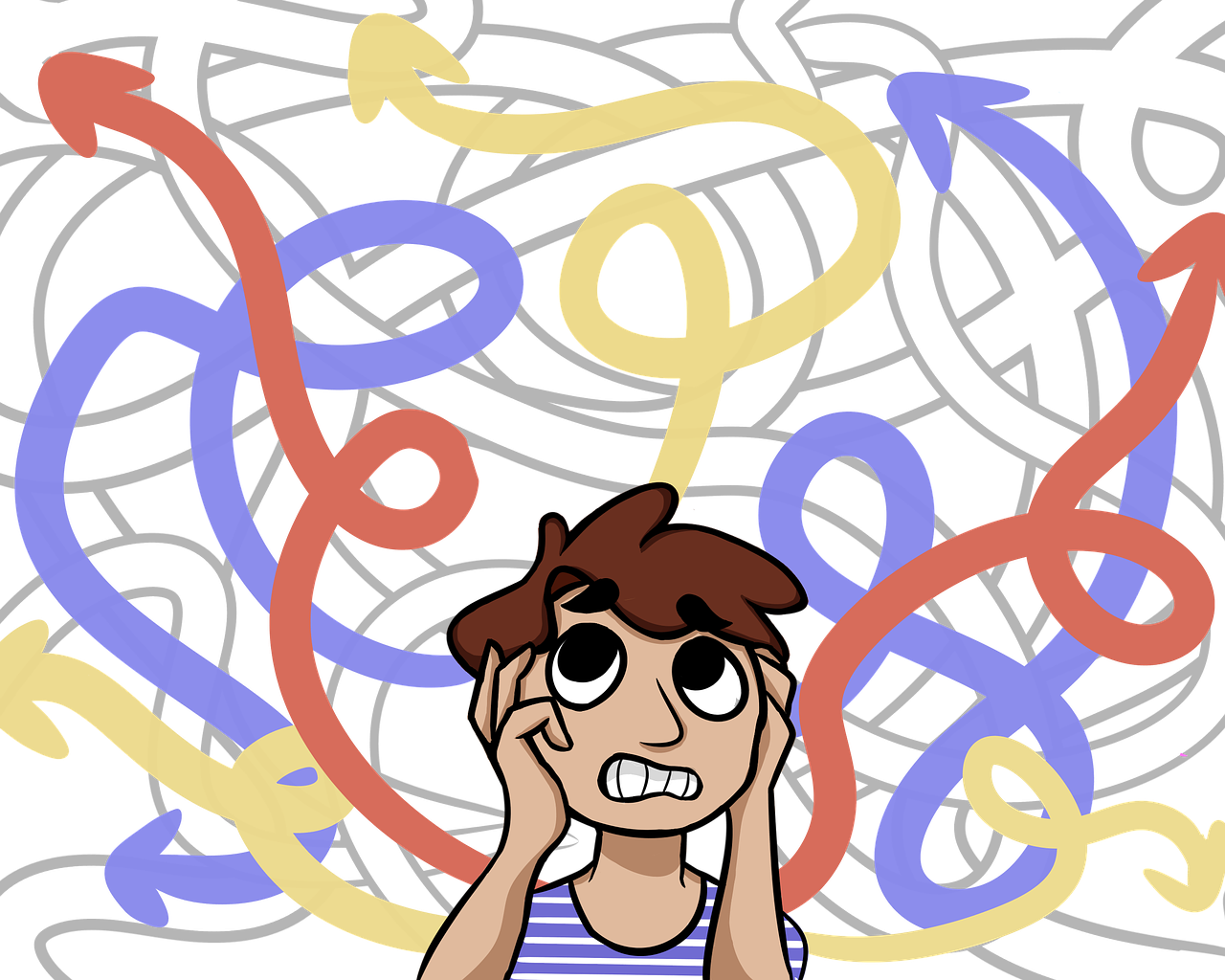



.jpg)




 Dates parcoursup
Dates parcoursup Dates épreuves écrites Brevet DNB 2025
Dates épreuves écrites Brevet DNB 2025 Les dates et les horaires des épreuves du Bac Général session 2025
Les dates et les horaires des épreuves du Bac Général session 2025 À quoi sert la mention au BREVET ?
À quoi sert la mention au BREVET ?